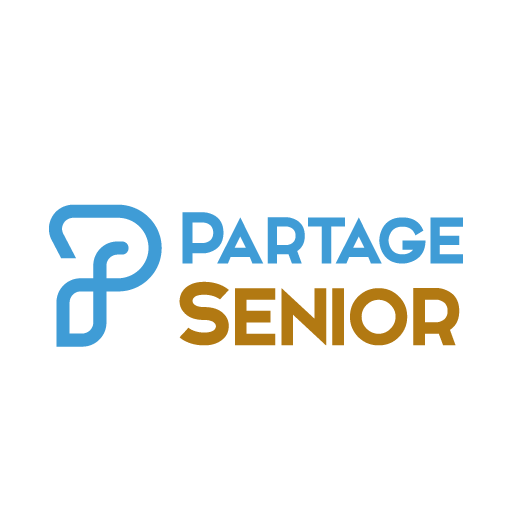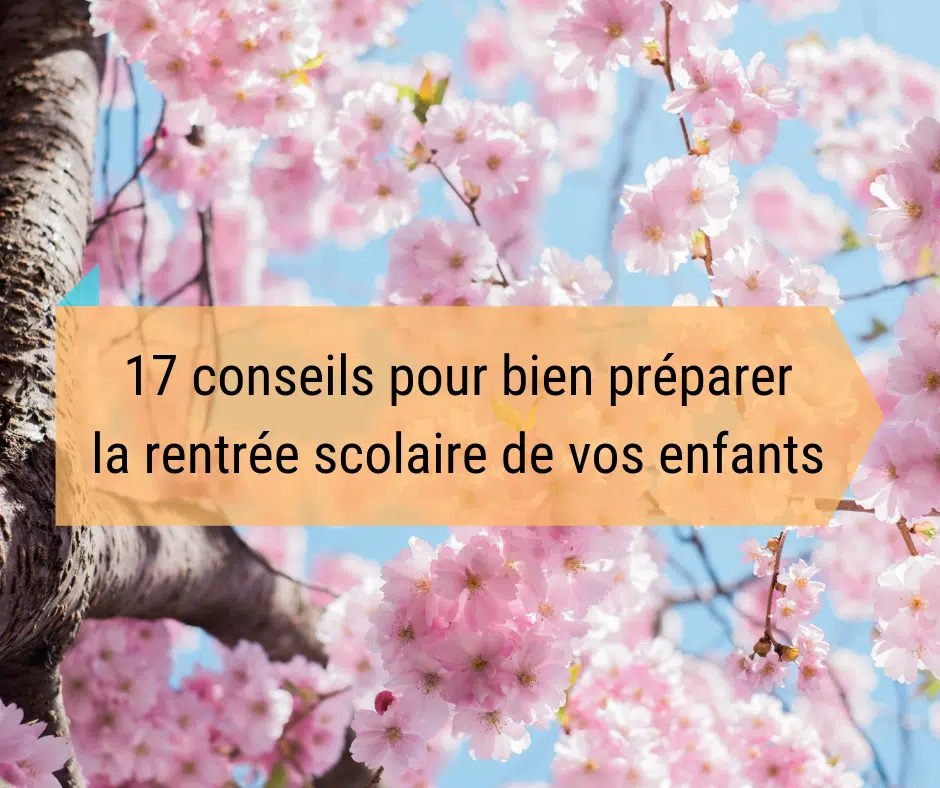La loi française distingue strictement les règles de transmission selon la nature des biens : les liquidités ne suivent pas toujours le même circuit que les biens immobiliers ou les objets de valeur. Dans certains cas, un compte bancaire peut être débloqué au profit d’un héritier sans attendre le partage officiel de la succession, sous réserve de plafonds et de formalités précises. Les contrats d’assurance-vie échappent au partage successoral classique, ce qui crée parfois des surprises au moment du règlement. Les droits des héritiers réservataires ne s’appliquent pas toujours de la même manière selon l’origine des fonds.
À qui reviennent les liquidités après un décès ?
Au décès d’un proche, les liquidités, comptes bancaires, livrets, placements financiers, ne se transmettent jamais sans formalités. Dès que la banque apprend le décès, elle bloque l’accès aux comptes du défunt. À partir de là, seuls les héritiers désignés par la loi ou par un testament pourront prétendre à ces sommes, et cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Le conjoint survivant bénéficie d’un régime particulier : il peut recevoir une part de la succession, voire obtenir l’usufruit sur les liquidités, selon le choix effectué après le décès.
Les choses se compliquent avec un compte joint. Le cotitulaire survivant conserve la possibilité d’utiliser le compte, mais la moitié du solde est considérée comme appartenant à la succession. Si les héritiers s’y opposent, la banque doit alors bloquer le compte jusqu’à la répartition officielle des fonds. Les enfants héritent en priorité, parfois en indivision avec le conjoint. Si le défunt n’avait pas d’enfant, les parents, frères et sœurs deviennent alors les héritiers légaux selon la dévolution prévue par le Code civil.
Voici ce que prévoit la loi pour les autres situations familiales :
- Le partenaire de Pacs ne reçoit rien, sauf si un testament le désigne expressément comme bénéficiaire.
- Le concubin n’a, lui non plus, aucun droit sur les liquidités du défunt.
- Les petits-enfants n’accèdent à l’héritage que par représentation, si leur parent (l’enfant du défunt) est décédé ou a renoncé à la succession.
La présence d’un adopté, qu’il s’agisse d’une adoption simple ou plénière, influe sur la répartition. Un enfant adopté de manière plénière possède exactement les mêmes droits que les enfants biologiques. En cas d’adoption simple, l’enfant hérite à la fois dans sa famille d’origine et dans celle de l’adoptant. L’ensemble des liquidités suit alors le schéma légal prévu pour le patrimoine successoral, le notaire ayant la responsabilité de veiller à la bonne application de ces règles.
Ce que dit la loi sur la répartition des comptes bancaires et livrets d’épargne
Au moment où s’ouvre la succession, la transmission des comptes bancaires, livrets, portefeuilles-titres est encadrée de près par la législation. Dès la déclaration du décès, la banque bloque tout mouvement sur ces comptes. Pour débloquer les fonds, les héritiers doivent présenter un acte de notoriété, document officiel délivré par le notaire ou le greffe, qui atteste de leur qualité. Il existe toutefois une tolérance : les frais d’obsèques peuvent être prélevés directement sur le compte du défunt, dans la limite de 5 910 euros.
Le défunt peut, par testament, désigner précisément qui recevra ses liquidités. En l’absence de volonté exprimée, la répartition des sommes suit la hiérarchie fixée par le Code civil. Le conjoint survivant échappe à toute taxation sur ce qu’il reçoit. Les enfants doivent s’acquitter des droits calculés selon le barème légal, après application des abattements. Les autres héritiers (parents, frères et sœurs) sont taxés selon leur degré de parenté.
Le notaire est le chef d’orchestre de la succession. Il collecte les documents nécessaires, rédige la déclaration de succession et supervise la répartition. Les droits de succession doivent être réglés dans les six mois suivant le décès. Un paiement échelonné ou différé est envisageable sous conditions, et la dation en paiement (règlement en œuvres d’art ou en immeubles, par exemple) reste possible pour certains biens.
Les héritiers sont tenus de répondre collectivement du paiement de ces droits auprès de l’administration fiscale. Une fois la procédure achevée et l’acte de partage établi, la banque libère les fonds selon les indications du notaire.
Quels sont les droits et devoirs des héritiers et de l’usufruitier ?
Répartir un héritage ne se limite pas à partager des liquidités sur un tableau Excel. Chaque héritier se voit attribuer des droits et des obligations spécifiques, selon qu’il est nue-propriétaire ou usufruitier. Le conjoint survivant peut opter pour l’usufruit sur l’ensemble des avoirs financiers : dans ce cas, il gère librement les liquidités (comptes, livrets…), tandis que les enfants en détiennent la nue-propriété.
Ce dispositif, souvent mal connu, permet à l’usufruitier d’utiliser l’argent, de le placer, voire de le consommer. Mais il ne s’agit pas d’un droit sans contrepartie : à la fin de l’usufruit (généralement au décès de l’usufruitier), la valeur équivalente doit être restituée aux nus-propriétaires. Cette forme de gestion, appelée quasi-usufruit, impose à l’usufruitier une gestion rigoureuse et transparente.
Pour baliser le terrain et éviter les conflits, la loi impose certaines précautions :
- Un inventaire détaillé des avoirs financiers est réalisé avant la remise des fonds à l’usufruitier ;
- Les nus-propriétaires peuvent demander une caution ou une garantie, pour limiter les risques de non-restitution ;
- Le recours à un notaire ou à un avocat s’avère souvent judicieux pour clarifier les droits et apaiser les tensions potentielles.
Les héritiers disposent de plusieurs options : accepter totalement la succession, l’accepter sous bénéfice d’inventaire (afin de limiter les dettes), ou la refuser. Cette liberté de choix s’accompagne d’une solidarité : chaque héritier doit répondre des dettes et charges de la succession, à hauteur de ses droits. La gestion de l’usufruit sur les liquidités soulève ainsi, au-delà des règles, des questions de confiance et de transparence entre héritiers.
Débloquer les fonds : étapes clés et conseils pour faciliter vos démarches
À la survenue du décès, la banque bloque immédiatement tous les comptes bancaires du défunt, une mesure destinée à sécuriser le patrimoine. Le cas du compte joint fait exception : le cotitulaire survivant conserve l’accès aux sommes, sauf si les héritiers s’y opposent formellement. Dans ce cas, la moitié des fonds est intégrée dans la succession.
Pour accéder aux liquidités, il faut d’abord réunir les documents nécessaires. La présentation d’un acte de notoriété, délivré par le notaire, prouve la qualité d’héritier. Grâce à ce document, la banque fournit un certificat de positions listant l’ensemble des avoirs au jour du décès. Les établissements bancaires autorisent le paiement direct des frais d’obsèques sur le compte du défunt, dans la limite de 5 910 euros.
Le notaire prend alors le relais : il orchestre la déclaration de succession, vérifie les droits de chaque héritier et supervise la distribution des fonds. Les droits de succession doivent être réglés dans les six mois, souvent via les sommes débloquées. Les éventuels crédits et dettes du défunt sont déduits de la masse successorale ; une assurance décès peut limiter la charge financière pour les co-emprunteurs.
En cas de conflit ou de situation bloquée, l’appui d’un avocat spécialisé en successions permet de défendre les intérêts de chaque ayant droit et d’éviter l’enlisement. Mieux vaut anticiper la collecte des justificatifs et agir rapidement : cela permet d’accélérer l’accès aux liquidités, pour que chacun puisse avancer, sans heurt inutile.